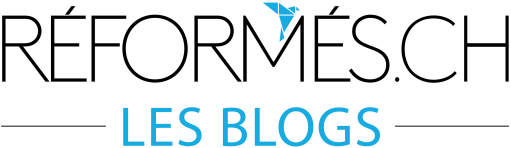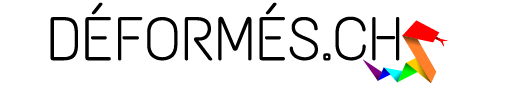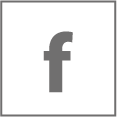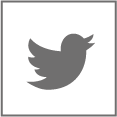Les ONG chrétiennes ont«une compréhension du temps long»
C’est en étudiant l’activisme de femmes musulmanes féministes dans les années 2000, qui se sont mobilisées contre les lois interdisant le port du voile en Turquie et en France, qu’Amélie Barras,chercheuse en sciences sociales à l’Université de York (Canada), a eu l’idée de se pencher sur les ONG religieuses actives à l’ONU. «Ce qui m’a intéressée, c’est le discours de ces activistes qui expliquaient que même si elles ne parvenaient pas à changer le droit dans leur pays, elles souhaitaient pouvoir placer leur question à l’agenda international.» Une sorte de «pied dans la porte» pour faire avancer leurs idées.
Amélie Barras s’est donc demandé ce qui motivait les acteurs religieux actifs au sein de l’ONU et notamment de son Conseil des droits de l’homme, « où sont discutés de nouveaux standards,un espace intéressant si l’on réfléchit aux droits humains comme concepts en mouvement», réuni trois fois par an au Palais des Nations de Genève. Elle a réalisé une enquête de terrain entre 2016 et2020, constituée d’observations, d’études de documents et d’entretiens avec des acteurs et des experts.
Quelles sont les ONG religieuses actives à Genève?
AMÉLIE BARRAS: La majorité d’entre elles sont des organisations chrétiennes, même si l’on trouve aussi d’autres groupes comme les bahaïs (religion monothéiste fondée au XIXe siècle en Iran, NDLR). C’est pourquoi ma recherche se focalise sur elles. Par rapport au siège new-yorkais de l’ONU, le Palais des Nations de Genève, par sa configuration –l’espace, les jardins –, favorise les possibilités de rencontre. Avoir un bureau permanent à Genève est aussi un atout. Cela demande d’importantes ressources, mais permet de continuer le travail de plaidoyer toute l’année.
Comment ces organisations traduisent-elles leurs convictions théologiques en langage juridique?
L’ONU est avant tout vue comme un espace séculier, ce qui explique pourquoi les ONG réfléchissent à la manière de s’y présenter. Certaines décident de ne pas rendre leur religiosité visible, d’autres font le choix contraire avec l’objectif d’interroger les frontières entre plaidoyer à l’ONU et religion. Les références théologiques directes restent rares – hormis envers l’encyclique catholique Laudatosi’ et son concept d’écologie intégrale, compris hors du monde chrétien. À l’inverse, plusieurs ONG, surtout celles qui disposent d’un réseau transnational de congrégations, s’attellent à traduire pour leurs membres les droits humains en concepts théologiques. Elles ont besoin de témoignages de terrain pour faire avancer leur plaidoyer, mais pour pouvoir solliciter ces informations, elles doivent convaincre leurs réseaux de l’importance de ce travail. Elles opèrent donc une relecture de textes religieux pour montrer que ceux-ci évoquent les droits humains– par exemple les droits au développement et à l’éducation sont essentiels pour combattre la pauvreté. Si la théologie ne se voit pas, elle sous-tend les actions, incluant le choix des thèmes investis.
S’agit-il de plaidoyers ou d’activisme? Quel est l’objectif de ces groupes religieux?
Il est difficile de séparer les deux. Pour plusieurs de ces ONG, leur engagement envers les droits humains fait partie de la manière dont elles vivent leur spiritualité. Leur possibilité d’impact se situe probablement sur une évolution sur le long terme du discours des droits humains. Leur compréhension du temps semble être plus longue que celle d’autres acteurs, parce qu’elles sont moins dépendantes de donateurs souhaitant des résultats rapides. Le bureau des quakers auprès de l’ONU se mobilise par exemple depuis les années 1960 pour faire reconnaître l’objection de conscience au service militaire comme un droit protégé. Un travail marqué par la patience et la détermination, d’autant plus que des renversements peuvent s’opérer:aujourd’hui, la notion d’objection de conscience est utilisée par d’autres acteurs pour justifier le refus d’avoir recours à l’avortement… Ce qui est loin de l’objectif initial du plaidoyer.
La recherche
Amélie Barras, Faith in Rights:Christian-Inspired NGOs at Work inthe United Nations, Stanford UniversityPress, septembre 2024, 234 p.