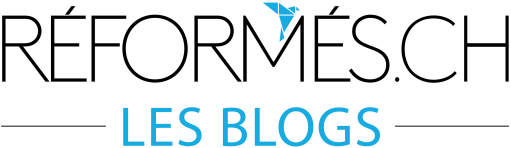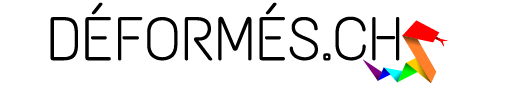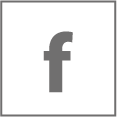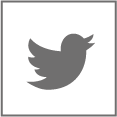«Rien n’est possible quand les armes parlent encore»
Comment une société se reconstruit-elle collectivement lorsque des crimes graves ont été perpétrés à son encontre? Les spécialistes parlent alors de justice transitionnelle, lorsque les droits humains ont été bafoués. Le Genevois Pierre Hazan, spécialiste de la médiation des conflits armés, a consacré sa vie à ces processus de réconciliation. Il donne notamment des cours sur cette justice transitionnelle en Israël et au Liban, mais a également travaillé dans le Donbass sur ces questions, avant l’invasion russe de 2022.
En quoi le pardon a-t-il une place dans les relations internationales?
Je parlerais plutôt de politiques de réconciliation qui peuvent se dérouler aussi bien après une guerre civile qu’entre des Etats. Le pardon peut être défini comme l’oubli juridique, c’est-à-dire l’amnistie, dont la première connue remonte aux guerres du Péloponnèse, autour du IVe siècle avant Jésus-Christ. C’est là qu’apparaît pour la première fois l’idée qu’il faut amnistier les crimes pour permettre la réconciliation. Cette approche traverse les siècles. Par exemple, le 1er article de l’édit de Nantes stipule que «la mémoire demeurera éteinte comme de choses non advenues», afin de ne pas raviver la vengeance et la violence.
Cette vision des choses est-elle toujours d’actualité?
Pas vraiment, non. Un renversement s’est opéré à la fin du XIXe siècle, notamment avec la psychanalyse et le développement du droit international. Avec la notion de crimes contre l’humanité, qui apparaît la première fois dans le contexte des massacres des Arméniens au début du XXe, et puis le procès Nuremberg, l’idée d’imprescriptibilité va également s’imposer. Désormais, on considère qu’il faut dire les crimes pour éviter leur répétition. Deux logiques vont dès lors s’affronter: l’une basée historiquement sur le silence, l’autre sur la parole, chacune affirmant que c’est le meilleur moyen de rétablir la paix civile.
Cet appel à parler a-t-il complètement remplacé l’injonction à ne pas remuer le passé?
Aujourd’hui, l’idée d’une parole qui libère est devenue hégémonique. L’idée est qu’il faut parler pour ensuite arriver au pardon, alors qu’auparavant, on faisait silence pour oublier et ainsi pardonner. Alors que l’amnistie posait une barrière temporelle, le développement de la justice internationale a aussi posé des limites au pardon avec l’imprescriptibilité pour les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide.
Le pardon suppose un agresseur et une victime clairement identifiés. Est-ce vraiment toujours le cas?
Non, évidemment. Par exemple, la Commission vérité et réconciliation (CVR) en Afrique du Sud a reconnu qu’il y avait eu des crimes des deux côtés, bien que de manière inégale. Il y a eu un grand débat sur le fait de savoir si les auteurs de crimes de guerre devaient ou non demander pardon. La décision a été de ne pas exiger d’excuses, de peur que celles-ci soient purement stratégiques et hypocrites. Le Rwanda, au contraire, a choisi l’exact opposé: il a imposé une demande de pardon explicite devant les gacaca (tribunaux populaires, ndrl) pour obtenir une libération après des années de prison. Donc, selon les cas, les politiques du pardon peuvent être très différentes.
Justement, comment se négocient ces politiques du pardon?
Ces processus relèvent du politique. C’est le gouvernement qui détermine le mixte entre les poursuites pénales et les politiques de réconciliation et de pardon, sachant qu’en théorie, les crimes les plus graves sont imprescriptibles.
En théorie? C’est-à-dire?
L’exemple de l’Afrique du Sud est le cas le plus connu. Nelson Mandela a renoncé à des procès des dirigeants de l’apartheid – ce que souhaitait pourtant la grande majorité de son peuple – pour éviter une guerre civile et un bain de sang. C’est comme cela qu’il a décidé de créer la Commission vérité et réconciliation. Le «marché» était de ne pas poursuivre pénalement les auteurs de crimes, pour autant qu’ils les avouent publiquement. Au final, dans la pratique, beaucoup de responsables de crimes d’apartheid n’ont jamais témoigné devant la CVR et n’ont jamais été poursuivis.
Qu’en est-il des conflits de longue durée comme le conflit israélo-palestinien? Peut-on espérer la mise en place, un jour, d’un processus de réconciliation?
Il y a des crimes qui sont imprescriptibles et la Cour pénale internationale s’est déjà saisie de certains d’entre eux. Pour des délits moins graves, l’idée d’une commission de vérité circule dans des milieux d’experts, de spécialistes, de militants de droit de l’homme. Donc cette idée n’est pas saugrenue. Mais aujourd’hui, alors qu’à Gaza les morts s’ajoutent aux morts, ce n’est ni souhaitable ni praticable. La justice, qu’elle soit pénale ou réparatrice, a besoin d’un minimum de stabilité, de sécurité et de volonté politique – autant de choses qui font défaut.
Et pour la guerre entre la Russie et l’Ukraine?
Pour l’instant, nous sommes dans le temps de la guerre, avec une justice militaire des deux côtés, outre les poursuites entamées par la Cour pénale internationale. Le jour où les armes se tairont, nous verrons si une volonté politique existe de sanctionner les auteurs des crimes les plus graves. Si le président Poutine reste au pouvoir, je n’y crois guère. Si l’Ukraine arrive un jour à récupérer tout ou une grande partie du Donbass, alors sans doute, il y aura la possibilité pour ce pays de faire un travail en termes de justice transitionnelle. Tout dépend des termes d’une future paix.