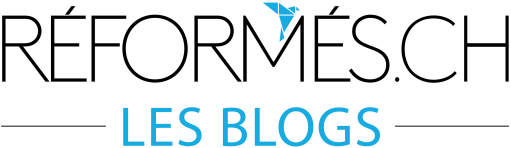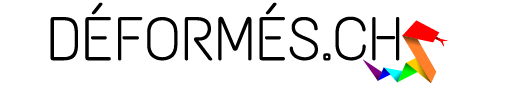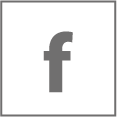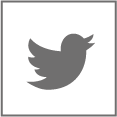L’aide au développement de demain
Kenya: Amorcer sa sortie de la dépendance
Confronté à une succession de crises – invasion de criquets, inondations meurtrières, résurgence du Covid-19 –, le Kenya a décidé de reprendre en main son système de santé longtemps dépendant de l’aide extérieure. Soutenu par le Programme des Nations unies pour le développement, le gouvernement a lancé en octobre 2024 un vaste plan de financement de 9 milliards de shillings (69,8 millions de dollars) pour éponger les dettes des hôpitaux publics et renforcer l’Autorité de la santé sociale. Un milliard est destiné à un programme pour des soins maternels gratuits.
Cette initiative s’inscrit dans une réforme plus large estimée à 1,3 milliard de dollars visant à bâtir un système de santé autonome, équitable et durable. Le ministre de la Santé a promis plus de transparence dans la gestion des remboursements, avec un suivi quotidien des paiements. Le Kenya espère ainsi devenir un exemple de souveraineté sanitaire du continent africain.
Rwanda: Quand le Sud aide le Nord
L’Eglise presbytérienne au Rwanda (EPR) a une longue histoire de partenariat avec des Eglises ou organismes du Nord, dont DM à Lausanne. Des partenariats ont ensuite émergé avec des Eglises du Sud, peu à peu renforcés à partir de 2007. L’EPR a développé «l’auto-prise en charge», soit des solutions pour répondre elle-même à ses défis. Elle a créé ses propres fonds pour l’évangélisation et l’éducation, et peut y puiser pour faire face aux destructions d’écoles après des catastrophes naturelles.
Depuis 2024, une coopération avec l’Eglise de Madagascar, mise en place via DM, permet un apprentissage conjoint dans le domaine de l’éducation. «Au début, cette démarche a suscité de la peur, comme si cela impliquait d’arrêter toute relation avec nos partenaires du Nord. Mais l’idée n’était pas du tout de couper les liens. Nous avons plutôt trouvé d’autres manières de les vivre», explique Pascal Bataringaya, président de l’EPR. Et effectivement, tout a changé. Plutôt qu’une relation de «donneur à bénéficiaire», l’EPR dialogue avec ses partenaires dans un esprit de coopération et de renforcement mutuel. En 2023, à la suite des inondations spectaculaires en Allemagne, l’EPR et des Eglises du Sud ont envoyé plus de 20'000 euros en soutien à leurs Eglises partenaires de Rhénanie-Palatinat.
Brésil: Connecter des protecteurs de la biodiversité
L’ONG EPER (Entraide protestante suisse) travaille depuis longtemps à rendre autonomes ses partenaires sur place en s’assurant qu’ils soient dotés de ressources, de compétences et de leadership locaux, selon le principe de la «localisation». Au Brésil, l’EPER accompagne ainsi des communautés de la Serra do Espinhaço, qui ont au fil des ans géré leur territoire et développé des pratiques soutenables comme la cueillette et la commercialisation de plantes endémiques. L’agrobusiness représente cependant une menace pour leur intégrité territoriale.
A partir de 2015, l’EPER a soutenu l’association de ces cueilleurs de fleurs (la Codecex) à travers un programme de microcrédits opéré par un partenaire brésilien local et en la connectant à d’autres acteurs. Puis une ONG et une coopérative locales ont commencé à commercialiser les fleurs de Codecex et à l’accompagner pour développer des produits innovants et durables. Une autre ONG les a aidés à défendre juridiquement les droits de leur communauté. Un cercle vertueux qui a conduit à la reconnaissance du territoire de ces cueilleurs comme Globally important agricultural heritage system par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture en 2020.