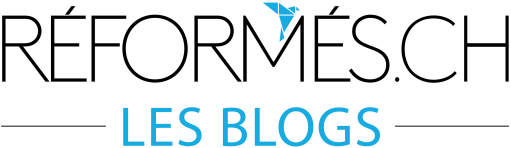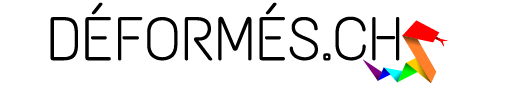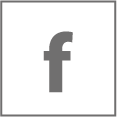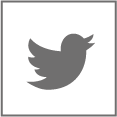Ethiques du rapprochement
Ils ont chacun leur méthode. Dans les Vosges, Alexandra Breukink, pasteure protestante d’origine néerlandaise et suisse, réunit dans son centre de rencontre ABC-Climont des personnes de différents milieux. «Je crois beaucoup aux mélanges.» Aucun prérequis, charte ou cadrage particulier: la ministre fait confiance au côté «organique» de la démarche.
L’été dernier, une Summer School a réuni de jeunes Libanais chrétiens, des Français athées, protestants et de culture juive, une Palestinienne et des Afghanes musulmanes. Explosif? Alexandra Breukink instille une série d’ingrédients pour «créer un climat de confiance où chacun se sent entendu»: l’hospitalité,d’abord. «On est dans une maison. Les gens sont invités à prendre soin des lieux, on cuisine ensemble…» Mais aussi des rencontres avec des experts (philosophes, artistes…) sur des thématiques entre spiritualité et actualité (cette année: l’espérance). Des références en lien avec les traditions de tous, «y compris les athées et les agnostiques, qui ont aussi leur propre corpus». Et, enfin, des visites de terrain – par exemple au camp de concentration du Struthof (Bas-Rhin).
A Lausanne, avec l’association de l’Arzillier qu’il copréside, le théologien et éthicien Dimitri Andronicos pratique des échanges réguliers avec des personnes de communautés établies dans le canton. Luimise sur un cadre constitué de «paliers».«L’interreligieux, c’est un acquis d’expérience.
Pour y parvenir, il faut d’abord être au clair avec sa propre provenance, son identité, les connaissances de sa propre religion», estime-t-il. Le premier seuil qu’il instaure a cet objectif. Plutôt que de démarrer par des échanges frontaux, il privilégie le format des tables rondes. «Ce n’est pas confrontant. On superpose les avis. Chaque appartenance peut se profiler et mobiliser ses ressources de manière ouverte et clarifiante.» Cette étape permet à chacun de découvrir «l’ampleur des débats, la diversité à l’oeuvre, les types de représentation…»
La tentation de changer l’autre
Place ensuite à une deuxième phase, avec des sujets théologiques, plus à même «de générer des crispations». Un exemple? «La place de Marie dans les différentes traditions.» Pour cette étape, Dimitri Andronicos estime qu’il est nécessaire d’avoir «une formation théologique et la capacité de remettre sa propre tradition en question». L’objectif? «Identifier jusqu’où j’accepte d’être remis en cause sans que mes convictions soient détruites pour autant.» Et renoncer à vouloir «changer» l’autre, tentation présente dans toutes les religions «englobantes, qui prennent en charge l’ensemble du réel. Du côté chrétien, par exemple, l’approche historico-critique est si prégnante que l’on a tendance à comprendre l’histoire de l’autre à partir de la nôtre, à lui imposer les mêmes méthodes, à le regarder à travers la même perspective».
Le but du dialogue est tout autre pour ces professionnels chevronnés. Il vise plutôt à accueillir l’autre dans toute sa complexité. «Cet été, la visite du camp de concentration a été un temps très fort.
C’était la première fois que des jeunes du Moyen-Orient approchaient concrètement ce pan de l’histoire européenne. C’est là que la parole s’est libérée autour de Gaza.
En entrant dans la souffrance de l’autre, une rencontre a été possible», explique Alexandra Breukink. Un moment qui évoque le «troisième palier» du dialogue conceptualisé par Dimitri Andronicos:«Se retrouver brièvement traversé par la spiritualité de l’autre et ses convictions, et peut-être transformé, illuminé. Fragile et incertain… mais c’est une utopie nécessaire!»