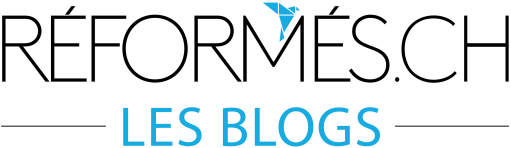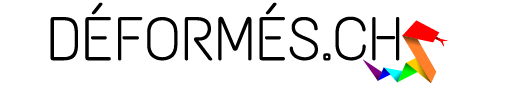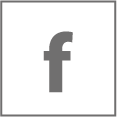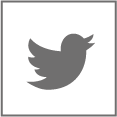« L’Eglise doit être au sein et hors de ses lieux traditionnels »
Etudiant en sciences de la communication, il est un familier des réseaux sociaux : le Biennois Adrien Despont est connu comme porteur du festival protestant romand BREF, mais il est aussi le visage d’« Eglise en route », qui « accompagne les paroisses dans des événements qui sortent de leurs habitudes ». Laurence Bohnenblust-Pidoux, théologienne et éducatrice, est membre du Conseil synodal de l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud (EERV), où elle a longtemps porté des projets et mis en place une formation dans le domaine de l’innovation, notamment autour de l’enfance, des familles et de la jeunesse, secteur qu’elle a coordonné.
Pourquoi l’Eglise doit-elle innover ? Pour renouveler ses membres ou pour atteindre un nouveau public ?
Laurence Bohnenblust-Pidoux Pour rejoindre la population qui a de nouvelles habitudes, pour s’adapter au changement qui a eu lieu. Le constat que l’on fait dans le canton de Vaud, c’est que l'Eglise a perdu tout un public, par exemple les familles qui envoyaient leurs enfants au catéchisme, les personnes qui n'étaient pas participantes régulières. Ces personnes ont disparu et je crois que c’est vers elles que nous devons aller. Il faut être à l’écoute de ceux qui ne participent plus. En plus de cela, je crois qu’il nous faut réapprendre à créer des projets avec les personnes. L’innovation c’est, finalement, redynamiser notre manière d’apprendre des autres.
Adrien Despont L’Eglise a loupé quelques wagons en matière d’évolution sociétale ces dernières décennies. Avant, il y avait peu de choses à faire ; maintenant il y a tellement de possibilités et les gens se déplacent davantage : je crois que c’est à l’Eglise d’aller vers eux. Elle doit aussi se connecter à d’autres acteurs. Par exemple, ce weekend un culte œcuménique aura lieu dans le cadre de la fête d’un village. C’est une manière d’être en lien avec le reste de la société.
L. B. Cela me rappelle une « journée enfance » que l’EERV a organisée à Aigle : nous avions fait le choix d’installer nos stands entre deux immeubles, sur l’espace public, car c’est là que les gens se retrouvent, et non dans l’église locale. Notre institution est propriétaire de lieux magnifiques, mais où paradoxalement les gens ont de la peine à entrer, sauf pour leur dimension historique...
L’Eglise doit-elle se préparer à fermer certains de ses bâtiments ou à s’en séparer ? Et comment ?
L. B. L’EERV a réalisé une enquête qualitative. Nous avons découvert que les lieux ne sont pas anodins. Les églises sont importantes aux yeux des gens, mais c’est difficile d’y entrer pour participer à des activités classiques. On aime ce lieu et on ne l’aime pas. C’est très paradoxal ! Pour moi, l’Eglise doit être au sein et hors de ses lieux traditionnels. Si on ne les habite plus, on perd son identité. Il faut colorer les lieux existants et, en même temps, diversifier notre présence. C’est ce que vous avez fait avec le festival BREF…
A. D. Oui ! Et c’est la ligne que nous poursuivons avec l’édition 2026. On aura des activités dans le temple de Martigny et d’autres à l’extérieur. Je sais que certaines personnes sont choquées quand des activités non cultuelles ont lieu dans des temples… Alors qu’elles ne les fréquentent pas comme lieux de culte et que dans le protestantisme, la notion de « sacré » est bien différente par rapport à dans d’autres religions ! Réinventer nos lieux existants est une question intéressante qui demande de trouver un juste milieu et de développer des projets. Dans le Jura bernois, tout fonctionne par région. Plutôt que de garder des églises « classiques » dans chaque village, il faudrait par exemple réfléchir où cela ferait sens de transformer un temple en loft. Mais avec une cohérence régionale, une réflexion en fonction du contexte local (forces et faiblesses, profil du ou de la ministre en place, lien avec le reste de la communauté, besoins sur le territoire…), l’avis du village, etc. On pourrait aussi imaginer que l’Eglise reste propriétaire et exploite des lieux comme un gérant. Cela demanderait d’avoir davantage de profils de gestionnaires dans nos institutions. Mais cela permettrait d’être rentable et de gagner de l’argent.
L. B. Une piste qu’explore par exemple l’Eglise protestante de Genève, si je ne me trompe pas. Avec la réforme que nous portons sur le canton de Vaud, Eglise 29, nous savons pertinemment que certains lieux garderont leur fonction classique et que d’autres seront transformés, certains abandonnés voire restitués à la commune. De beaux projets sont déjà nés : dans une commune, l’église est également devenue une salle communale. On y a gagné un WC, une cuisine, un beamer, des spots. Et la commune, de son côté, a pu disposer d’un nouvel espace pour des anniversaires, des fêtes, des temps pour l’enfance ou la jeunesse. Alors, certes, il n’y a plus d’autel en pierre mais une table en bois. Mais cet exemple permet de suggérer aux communes que l’on pourrait avoir des églises qui soient des lieux de rencontre, autant communales que religieuses… Dans les cantons où l’Eglise reste propriétaire des bâtiments, on peut aussi imaginer des lieux mixtes qui mêlent logements et espaces communautaires.
Cela nous amène à la question des valeurs. Si l’on est présents dans des lieux mixtes, si l’on gère des projets ouverts à toute la société, que veut-on faire connaître du christianisme ? Pour vous, le cœur du message à partager avec une société sécularisée ce serait quoi ?
A. D. Deux pistes me tiennent à cœur. D’abord réactualiser la signification de temps auxquels les gens sont attachés et qui, sans qu’ils le sachent toujours, sont issus du christianisme : les dimanches, Noël, l’Ascension… Des valeurs chrétiennes sont toujours implantées au cœur de la société, il faudrait pouvoir partir de cette réalité toujours présente pour retravailler notre message. Et puis recréer du lien. On sait aujourd’hui que l’attention est la nouvelle valeur qui compte. Comment reconstruire du lien ? La recherche spirituelle, le développement personnel sont en vogue, mais sans lien avec nos Eglises. Il faudrait pouvoir réussir à dire ce en quoi nous croyons, quitte à le simplifier un peu, pour pouvoir toucher les gens qui sont dans ces quêtes de sens. Pour moi, proposer un stand avec Terre Nouvelle (organisation écologique et de solidarité alimentaire avec les Pays du Sud, NDLR) lors d’une fête de village est déjà une manière de transmettre des valeurs chrétiennes sans grand discours théologique, mais par de petits pas concrets.
L. B. Oui l’entraide est, je crois, un bon levier, et faire connaître cette valeur est un bon moyen de promouvoir nos valeurs. Mais pour moi, s’il y avait une valeur à redire, à faire découvrir, c’est celle de l’espérance. Ce n’est peut-être pas notre spécificité – beaucoup d’autres religions la portent – mais on devrait pouvoir parler du fait que notre foi et notre spiritualité nous amènent à dire que quand tout est fermé, des choses peuvent s’ouvrir. L’espérance ne signifie pas que tout va bien, mais que tout n’est pas perdu. Personne n’est jamais totalement perdu, pas même le monde ! C’est une des valeurs que je voudrais transmettre aux générations suivantes.
Reste à trouver une manière de s’adresser à elles. L’Eglise a-t-elle un problème de langage ?
A. D. Je dirais qu’elle a en priorité un problème de ressources. On engage des pasteurs en leur demandant de faire énormément de choses alors que leur compétence principale (avec leur formation actuelle) est la théologie. Il nous faudrait des gens dont la compétence principale est la communication, la vulgarisation, la pédagogie et qui, en plus, dans un second temps, ont des connaissances théologiques. Il faudrait peut-être une diversité de profils et une réinvention de la formation.
L. B. De notre côté, nous essayons de réunir des équipes pluridisciplinaires : pasteurs, diacres, animateu·trices d’Eglise… avec des profils différents et complémentaires. Mais on tient à avoir de vraies compétences, tout le monde ne peut pas tout faire. Et de vrais projets doivent cibler de vrais publics. Cela ne veut pas dire que si l’on fait des activités jeunesse, on refuse la participation de personnes plus âgées, mais que l’on sait à quels jeunes on s’adresse et ce qu’on leur propose. Cela demande d’oser faire de vraies propositions (œcuméniques, jeunesse, musicales…), d’afficher une couleur et de se dire que les gens se déplaceront pour cela. S’adresser à tout le monde, c’est ne parler à personne.
A. D. Oui, et cette couleur c’est le Conseil de paroisse qui peut contribuer à la donner. Et il peut la changer selon le pasteur qui arrive. J’ai observé des ministres arriver dans des paroisses où, parce qu’un événement avait eu lieu deux fois – par exemple une soirée ciné –, on considérait que désormais c’était acquis, que c’était un rite immuable. Parfois, on oublie de se reposer la question de ce que l’on veut vraiment…
L. B. Oui et cela implique de renoncer, ce qui est toujours difficile. Mais il faut être conscient que si l’on ne cesse pas certaines activités qui ne fonctionnent plus, on renonce de fait à la créativité, à la nouveauté et à l’avenir… Je me souviens avoir vu une communauté dite « fresh expression » au Royaume-Uni : ils avaient constaté qu’il existait tellement d’offres cultuelles chrétiennes dans leur quartier, qu’ils n’allaient pas pouvoir se démarquer. Alors, ils ont décidé de créer plutôt une maison de quartier. C’est très courageux !
Faut-il s’adresser au grand public ou se dire que c’est une chance d’avoir encore des communautés mêmes déclinantes ? Quelle est la priorité pour vous ?
L. B. En Suisse, les gens sont encore imprégnés de christianisme, des archétypes demeurent. Pour moi, l’enjeu est de créer des lieux où l’on peut proposer une présence mais d’une autre façon. Et tout l’enjeu est de faire connaître ces lieux. Ce n’est vraiment pas simple… L’autre piste, comme évoqué, est de sortir et d’aller à la rencontre des gens. C’est ce que l’on avait fait sur des marchés avec un jeu basé sur une « roue du destin » qui permettait à des pasteurs d’amorcer une conversation sur des questions existentielles. C’est aussi ce que permet l’opération Sapin solidaire durant l’Avent, où l’Evangile n’est pas évoqué, mais où l’Eglise assure une présence à travers une action de solidarité, et incarne directement ses valeurs.
A. D. Pour moi, il faut les deux : des offres traditionnelles car il y a toujours des gens qui ont envie et besoin de cela. Mais ce qui m’intéresse, c’est de réfléchir à de nouvelles offres, au niveau d’une paroisse, d’un canton… et d’articuler cela avec les propositions plus classiques ! Où est-ce pertinent d’innover ? Les besoins en ville ne sont pas les mêmes qu’à la campagne. Comment créer du lien avec le reste de la société ?
L. B. Je suis convaincue qu’il faut continuer à s’adresser à tout le monde, mais avec diverses offres. Une paroisse ne peut pas s’adresser à tout le monde. Et il faut des propositions qui correspondent à différentes catégories, y compris sociales et culturelles. Il y a des jeunes très internationaux et européanisés, d’autres qui démarrent un apprentissage et ont des questionnements liés à leur vie active. Cette diversité se retrouve aussi parmi les familles, les couples, les retraités, etc.
Le terme « évangélisation » reste un tabou côté réformé. On parle souvent de « propositions » ? Quelle distinction faites-vous entre les deux ?
L. B. Pour moi, il faut se dire que l’on apporte une bonne nouvelle, mais que ce n’est pas la seule. Oui, nous sommes une proposition parmi d’autres, mais c’est uniquement en incarnant l’enrichissement que cela nous procure que nous pouvons l’apporter. Vouloir convaincre les autres que l’on a raison ne fonctionne pas. Partager ce qui nous fait grandir, témoigner de ce qui nous nourrit, oui.
A. D. Oui, dans les projets que je conçois, il y a toujours un élément fun et ludique. Les gens peuvent s’arrêter à cela, mais ils sont aussi libres d’entrer dans une discussion plus profonde s’ils le souhaitent. C’est vraiment eux qui décident jusqu’où ils s’emparent de cette proposition. Ce terme a mauvaise réputation… Je ne l’utilise pas. Pour moi, l’essentiel c’est plutôt d’amener des valeurs.
Comment faire pour être pertinent sur les réseaux sociaux lorsqu’on porte un message parfois complexe, nuancé ?
A. D. L’Eglise bernoise a imaginé un projet pilote où plusieurs acteur·trices de l’Eglise – organiste, ministre, diacre… – réalisent une courte vidéo et racontent quelque chose. Je trouve cela intéressant, tout comme je trouve des contenus pertinents pour les jeunes, produits par des catholiques, sur les réseaux sociaux en France. Je crois qu’il faut oser avoir une diversité d’offres sur les réseaux sociaux. Se dire que chaque Eglise dispose de son propre canal est une erreur.
L. B. Oui, il faut unir nos forces, surtout en Suisse romande. Je pense que l’enjeu est de réinterpréter nos thèmes théologiques. Certaines notions ne résonnent plus aujourd’hui. Quand les chrétiens discutaient âprement de la Trinité, c’est que l’enjeu de cette discussion apportait réellement quelque chose en plus à leur existence. Aujourd’hui, je pense par exemple que la notion de libération des péchés n’est plus comprise. Pourtant il me semble que la notion de libération est importante : qu’est-ce qui libère les gens, qui amène quelque chose de nouveau dans leur vie ? Je crois, par contre, qu’il ne faut pas partir uniquement des thématiques bibliques, mais aussi des problématiques existentielles que connaissent les gens. Et je suis convaincue qu’il y a tout un travail de « traduction » à mener…
A. D. De réforme !
L. B. Exactement. Y compris sur le langage. Un terme comme « Seigneur », qui avait tout son sens à une époque, est connoté aujourd’hui. Des manières plus intuitives et actuelles, qui apportent plus de joie et de liberté, existent pour nommer Dieu... Il y a donc une réforme à mener en théologie systématique. Et dans le domaine de la liturgie, il faut comprendre vraiment ce qu’était un culte pour pouvoir réfléchir à repenser les célébrations aujourd’hui.
A. D. Moi, l’un de mes rêves serait de faire un Tataki réformé, un média jeune qui connaît les codes du reste de la société et propose une série de mini-vidéos racontant quelque chose, en plusieurs épisodes de quelques minutes.
L’écologie est clairement LE domaine qui a permis une rencontre inédite ces dernières années entre les chrétiens et d’autres groupes sociaux. Un momentum a réellement eu lieu en Suisse romande entre 2015 et 2019. Voyez-vous d’autres lieux de convergences potentiels ?
L. B. Peut-être dans les domaines où les aumôniers travaillent autour de missions communes, notamment les soins palliatifs. Le terme « convergence » est intéressant parce qu’il montre qu’on peut se réunir, se mettre au service, faire ensemble autour de valeurs, même si tout le monde ne se définit pas comme chrétien. On ne peut pas reproduire ce momentum mais il doit nous aider à rester attentif à d’autres conjonctions, à savoir se mettre au service. C’est ce que l’EERV fait lorsqu’elle est sollicitée : nous venons ainsi d’ouvrir une aumônerie pour écouter des jeunes qui sont dans les écoles de transition, tout comme nous avons ouvert il y a quelques années une aumônerie agricole, face à une vague de suicides parmi des paysans.
A. D. Oui rester à l’écoute, c’est aussi essayer, tester des choses. Il n’y pas de recette toute faite…
L. B. Parfois, en effet, cela ne marche pas. Mais l’échec c’est de ne pas essayer…
Comment faire souffler cet esprit d’innovation dans des institutions parfois lourdes à manœuvrer ?
A. D. J’ai la chance de venir de l’Eglise bernoise, qui a lancé le projet « KirchInbewegung/Eglise qui bouge », où l’idée est de financer des projets de manière assez large et sur trois ans, sans demander de résultats immédiats ni de comptes à rendre. L’idée est vraiment de pouvoir tester des idées. Certaines initiatives s’arrêtent, d’autres sont prolongées et entrent dans une seconde phase de financement et sont peu à peu intégrées comme des offres classiques de l’institution. Je pense que ce concept pourrait être reproduit côté romand. L’un des concepts qui a essaimé est le « Ritual Agentur », soit des pasteurs qui proposent de faire des célébrations dans des lieux insolites (en plein champ, dans la forêt etc…), avec un site web propre.
L. B. J’ai longtemps porté de telles initiatives et j’ai choisi aujourd’hui d’agir dans la structure de l’institution pour permettre à ces projets innovants de se lancer et d’exister. Dans les changements opérés côté vaudois par le projet Eglise 29, il y a l’idée de créer des pôles. En effet, pour être pérennes, ces innovations ont besoin d’une existence légale, d’un cadre reconnu. Maintenant, il faut que ces pôles se créent, que les paroisses se fédèrent et qu’elles créent quelque chose. C’est un défi...
A. D. Je réalise, en échangeant, que nous émanons des deux principales Eglises romandes – Vaud et Berne –, et que notre rôle est peut-être aussi de soutenir les autres Eglises de ce côté de la Sarine…
L. B. C’est aussi pour cela que je suis dans la Conférences des Eglises réformées romandes : nous avons tout à gagner à mutualiser nos compétences et nos forces. Ensemble nous sommes plus riches de nos savoirs. [Signature] Propos recueillis par Camille Andres
Questionnaire de Proust
Votre manière de rester en lien avec l’époque ?
A. D. Travailler à l’Eglise et étudier à l’Uni m’offre un bon équilibre. Cela me permet de garder un cercle d’amis et des engagements hors de l’Eglise. Et bien sûr les réseaux sociaux.
L. B. La littérature de science-fiction et la fantasy actuelles, une manière de se tenir au courant des transformations du présent !
Où trouvez-vous votre joie ?
A. D. Avec Eglise en route, j’ai la chance de piloter en quelque sorte une voiture qu’une équipe précédente a montée pour moi. Le poste et le budget sont parfaitement définis. On verra comment le festival BREF est soutenu à l’avenir par d’autres institutions. C’est un joli défi aussi.
L. B. Je vois l’innovation comme une source qui s’infiltre dans les interstices et les agrandit. C’est une chance dans mon ministère de pouvoir permettre aux gens de lancer des projets.
Une œuvre qui vous a inspiré récemment ?
L. B.Dune, deuxième partie. Le film de Denis Villeneuve (2024) offre une bonne réflexion sur la manière dont le pouvoir peut transformer une personne, comment un sauveur devient un dictateur.
A. D. L’album Caméo de Suzane et globalement tous ses titres pour sa capacité à partager de manière entraînante et mélodique de vrais enjeux de la société actuelle mais aussi personnels.
Une personne que vous admirez pour sa capacité à s’adresser à différents publics ?
L. B. Frère Roger, le fondateur de la communauté œcuménique de Taizé, qui a réussi à réunir des jeunes alors qu’il ne l’était pas et ne faisait pas semblant de l’être.
A. D. L’influenceuse Lena Situations, qui crée un lien unique, sur la durée, avec son audience, réussit à provoquer de l’attente, et sait prendre en compte les préoccupations de son public.