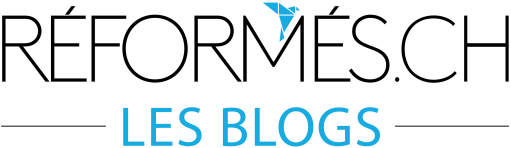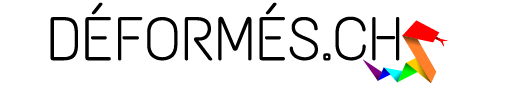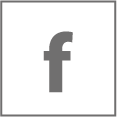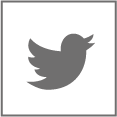Les ONG face à la dépendance et à l’héritage colonial
Martín Pérez, Bolivie

Directeur de Solidar Suiza Bolivia, ONG suisse engagée en Bolivie pour de meilleures conditions de travail, la démocratie et la lutte contre les violences faites aux femmes, qui implique aussi les jeunes dans des projets artistiques et sociaux.
«Le financement des ONG en Bolivie est en forte baisse. Cela résulte du faible soutien de l’Etat et de la diminution de l’aide internationale. Face à cette situation, certaines ONG se transforment en entreprises sociales. Elles génèrent des revenus qu’elles réinvestissent dans leurs projets. D’autres, comme nous, forment des alliances stratégiques avec des partenaires locaux et internationaux. L’objectif est de diversifier nos sources de financement et de maximiser notre impact.
En Bolivie, les ONG se trouvent à la croisée des chemins. La crise climatique, les dérives démocratiques et les inégalités abyssales rendent notre travail de plus en plus difficile. Notre pays figure parmi les plus inégalitaires du monde. Répondre aux besoins urgents des populations vulnérables ne suffit plus. Nous devons innover et proposer des solutions durables. Dans un contexte politique et économique polarisé, il nous faut repenser notre organisation. Tisser des alliances stratégiques avec le secteur privé et des partenaires internationaux devient essentiel pour conserver notre indépendance et influencer le développement du pays. La régulation des ONG, insuffisante pour les entreprises sociales, nécessite un débat urgent. Cependant, elle est éclipsée par la crise économique. Les ONG doivent innover pour soutenir les populations vulnérables.»
Jerry Kazadi, Rwanda

Acteur de l’aide au développement sur le terrain.
«La dépendance des ONG aux financements étrangers résulte d’une relation inégale entre l’Occident et le Sud. Cela soulève des questions sur l’autonomie des Etats africains et l’impact de l’aide internationale sur leur souveraineté économique.
Une situation renforcée par la mauvaise gouvernance dans certains pays, où les ONG se sont retrouvées à pallier l’incapacité des Etats à répondre aux attentes de leurs citoyens. Cela a diminué la capacité des gouvernements à se prendre en charge et accentué leur manque de redevabilité envers leurs populations.
La réduction des financements a des conséquences directes sur les systèmes de santé, comme le montre la situation dans certains pays africains. Le retrait des financements occidentaux fait partie d’une dynamique plus large, où l’Europe et la Chine, bien présentes, adoptent une posture pragmatique de compétition sur le terrain.
Pour sortir de cette dépendance, je plaide pour une révolution du financement: les gouvernements africains doivent développer des ressources internes, grâce à une gestion transparente de leurs richesses.
Selon moi, l’aide internationale devrait également évoluer pour respecter la dignité des bénéficiaires et non renforcer une logique de dépendance où ceux qui reçoivent l’aide sont invisibilisés et dévalorisés. Aujourd’hui, le défi est de taille!»
Repenser l’aide: les voix du Sud
L’aide au développement est critiquée par des intellectuels du Sud, comme l’économiste zambienne Dambisa Moyo, qui, dans le livre L’Aide fatale, dénonce son inefficacité, son rôle dans la corruption et le renforcement de l’instabilité institutionnelle et le frein qu’elle constitue pour la croissance. Elle propose un modèle basé sur le commerce et les investissements privés, loin de la dépendance aux prêts internationaux. Cette critique rejoint celle de figures comme Frantz Fanon, Walter Rodney et Samir Amin, qui considèrent l’aide comme néocoloniale. Ils en appellent à des systèmes économiques internes et à des investissements privés pour un véritable développement durable.
Pour aller plus loin
• L’Aide fatale, Dambisa Moyo, Editions Jean-Claude Lattès, 2009.
• Les Damnés de la Terre, Frantz Fanon, Editions Maspero, 1961, 3e édition 2002.
• Comment l’Europe sous-développa l’Afrique, Walter Rodney, Editions B42, 2025.
• L’hégémonisme des Etats-Unis et l’effacement du projet européen, Samir Amin, Editions L’Harmattan, 2000.